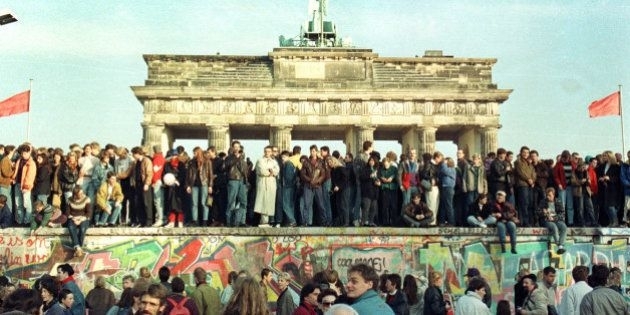La délégation russe qui est venu en France pour les célébrations du centenaire de l’armistice le week-end dernier, a été très marqué, impressionné, et touché par cet hommage la veille du 11 Novembre aux 15 soldats russes « morts pour la France, et enterrés dans le carré militaire de Vanves. La plupart hospitalisés au lycée Michelet, transformé alors en hôpital, sont décédés des suites de leurs blessures, que ce soit le capitaine Nicolas Voloschinoff, les soldats Marouchine ou Kertachaw, en passant par le sous-lieutenant Alexandre Remizoff,
L’empereur Nicolas II avait accepté d’envoyer des soldats russes, répartis en deux brigades, au prix d’une transaction, c'est-à-dire en échange d’armes, notamment, pour participer à cette guerre. Ils sont arrivés début 1916 en France et ont participé début 1917 à l’offensive et l’échec cuisant du chemin des Dames où ils ont perdu 5000 soldats. Ils ont connus toutes les vicissitudes journalières du front avec des pertes significatives. ayant fait partie des premières vagues qui se précipitaient sur les tranchées allemandes sous les bombardements qui s’efforçaient d’arrêter leur progression … Ses deux brigades ont été citées à l’ordre de l’armée.
Mais en février 1917, la Révolution bolchévique est déclenchée par Lénine à Saint-Pétersbourg. Les soldats du corps russes sont préoccupés car ils ont profondément ressenti ses événements de Russie, prémices de la révolution d’octobre (le 15 mars le tsar a abdiqué, et le 13 avril les militaires ont prêté serment à un gouvernement provisoire). Alors qu’ils se sont installé sur leur base de départ face à Courcy et à la butte de Brimont à la veille de l’offensive du 16 avril 1917, les soldats du 1er régiment de la 1ére brigade s’agitent sérieusement. Ils prennent contact avec les autres unités et se réunissent en « soviet » la nuit dans les caves d’une verrerie abandonnée pour se prononcer sur leur participation à l’attaque. Beaucoup étaient des ouvriers de Moscou, gagnés aux idées bolcheviques, qui voulaient aller prendre part à la Révolution dans leur pays. Les paysans, avertis des premières mesures de partage des terres exigeaient leurs droits : « On distribue les terres, nous arriverons trop tard pour obtenir notre part légale ! ». Après trois heures de délibération, ils votérent à main levée pour participer à l’attaque à une courte majorité. « L’incident est clos, mais on a frôlé la catastrophe »
Pour éviter une contamination des troupes françaises, il est décidé de partager les deux brigades : la 1ère, plutôt « rouge » est envoyée dans un camp militaire, la Courtine; la 2ème, plutôt loyaliste, ou « blanche », est dirigée sur Felletin, également dans le département de la Creuse. Placer les deux divisions dans des camps proches est une erreur. A La Courtine, les Russes pro-Lénine créent des comités bolchéviques et exigent le retour immédiat en Russie. Ils essaient également de rallier les Russes loyalistes. Le camp est transformé en une faction autogérée. L’Ukrainien Globa prend la tête du mouvement. Les soldats russes profitent également de leur isolement pour fraterniser avec les populations locales et coopèrent aux travaux des champs. Effrayé à l’idée que les idées bolchéviques ne contaminent la population, l’Etat-major de l’Armée française envoie plus de 3.000 hommes pour mater la rébellion. Les populations civiles sont évacuées le 12 septembre 1917 à la périphérie du camp, et le surlendemain, La Courtine est pilonnée à coups de canon. Rapidement matés, au prix de 150 morts, les soldats russes se rendent. Globa est arrêté.
Le Gouvernement français offre aux soldats russes trois possibilités : s’engager dans l’armée française, être volontaires comme travailleurs militaires, ou partir pour un camp en Afrique du Nord. Près de 400 hommes, équipés et armés par la France, vont former une légion russe qui s’illustrera en 1918 dans les batailles de la Somme, du Soissonnais, du chemin des Dames. Environ 4 800 réfractaires sont envoyés en Algérie ou au Maroc pour travailler dans les mines ou le chemin de fer, ou remplacer dans les fermes, les fellahs envoyés au front, alors que plus de 11 000 Russes sont volontaires pour le travail en France. Quant aux Russes de Vanves, certains se sont installés et ont fondés une petite communauté d’expatriés. En 1931, ils ont crée la paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité qu’ils ont décorés avec des icônes rapportées de la Mère patrie.